Quand Dorothy Rhau parle, ce n’est pas pour occuper l’espace. C’est pour forcer une question collective. Connue d’abord comme la première femme noire humoriste francophone au Québec, elle est ensuite devenue une figure majeure de l’entrepreneuriat social, notamment en fondant Audace au féminin et le Salon international de la femme noire. Elle porte aussi la campagne « Tétons bien drôles« , qui dénonce les inégalités de traitement du cancer du sein chez les femmes noires et racisées. Au-delà de la scène et des projecteurs, elle travaille sur le terrain, avec les femmes, les organismes, les bailleurs.
Et c’est précisément parce qu’elle est au cœur des réseaux — financements, accompagnement, mobilisation — qu’elle a pris publiquement la parole pour dire tout haut ce que beaucoup disent tout bas : la multiplication d’initiatives dans les communautés noires, notamment autour de l’entrepreneuriat, n’est plus un signe de vitalité. C’est en train de devenir un frein.
Quand « plus » veut dire « moins »
Son constat est frontal : depuis quelques années, on voit émerger une série de salons, de galas, de programmes d’accompagnement, de sommets, tous censés soutenir les entrepreneur·e·s noir·e·s, les artistes noir·e·s, les femmes noires. Chaque nouveau projet se présente comme « essentiel », « inédit », « nécessaire ». En théorie, c’est beau. En pratique, c’est problématique.
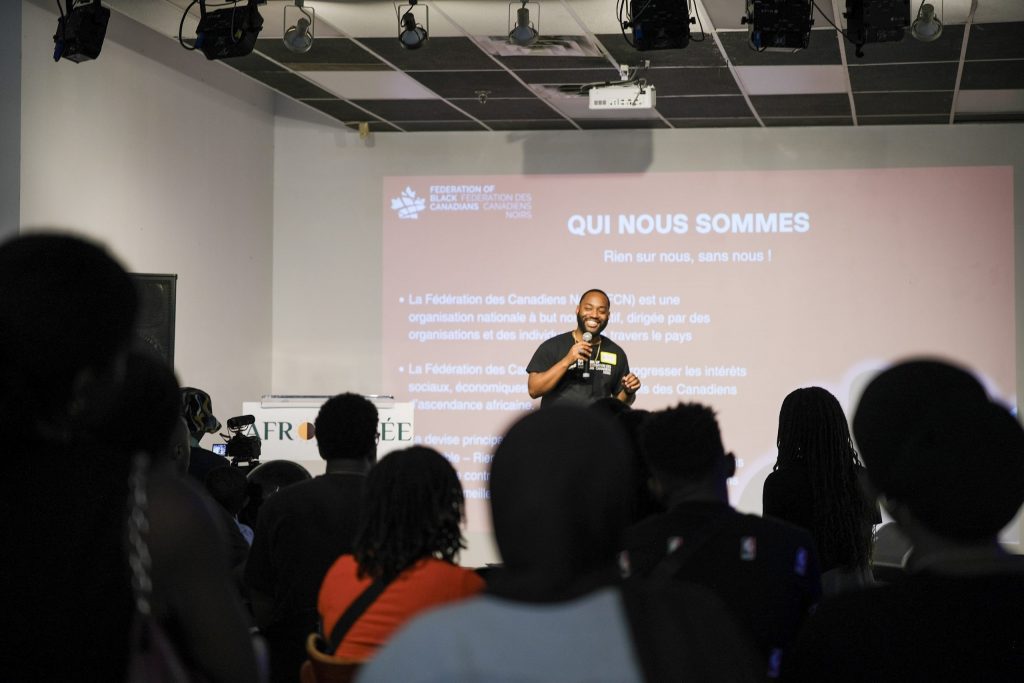 Pourquoi ? Parce qu’on touche souvent le même public, avec les mêmes promesses, dans les mêmes villes et parfois avec les mêmes intervenants. Les mêmes entrepreneures, par exemple, circulent d’un organisme à l’autre et sont comptées plusieurs fois comme « cas accompagnés », pendant que d’autres ne reçoivent aucun soutien. Les exposants se retrouvent invités à tous les salons, parfois pour des résultats inégaux. Les bailleurs, eux, se font approcher par une pluie d’acteurs qui disent faire sensiblement la même chose. Résultat : la crédibilité de l’écosystème s’effrite.
Pourquoi ? Parce qu’on touche souvent le même public, avec les mêmes promesses, dans les mêmes villes et parfois avec les mêmes intervenants. Les mêmes entrepreneures, par exemple, circulent d’un organisme à l’autre et sont comptées plusieurs fois comme « cas accompagnés », pendant que d’autres ne reçoivent aucun soutien. Les exposants se retrouvent invités à tous les salons, parfois pour des résultats inégaux. Les bailleurs, eux, se font approcher par une pluie d’acteurs qui disent faire sensiblement la même chose. Résultat : la crédibilité de l’écosystème s’effrite.
« La force d’une communauté ne vient pas du nombre de chapelles, mais de sa capacité à agir ensemble. »
La fondatrice de Audace au Féminin utilise une image parlante : « On dirait que chacun veut construire sa propre église.« » Au lieu de renforcer une structure forte et lisible, on crée des chapelles parallèles dans la même rue, avec les mêmes fidèles, les mêmes ressources, la même quête de légitimité. À force de dédoubler, on dilue.
Une fragmentation qui affaiblit la puissance collective
Derrière cette duplication, il y a plusieurs effets en chaîne.
- D’abord, l’essoufflement du public cible. Les mêmes gens sont sollicités sans arrêt : viens à mon gala, inscris-toi à mon incubateur, participe à mon panel, paie ta table à mon événement. L’intérêt finit par chuter. On crée de la fatigue, pas de la mobilisation.
- Ensuite, la confusion stratégique. Quand dix organisations prétendent soutenir « l’entrepreneuriat noir », mais sans coordination claire ni spécialisation assumée, la communauté elle-même ne sait plus vers qui se tourner. Et les bailleurs de fonds — institutionnels, privés, publics — le remarquent. Quand ils perçoivent de la redondance, ils doutent. Et quand ils doutent d’un, ils doutent de tous.
- Enfin, la perte d’effet levier. Chaque organisme va chercher « sa » subvention, monte « son » projet, raconte « son » impact. Mais au lieu d’aller ensemble chercher une enveloppe structurante, lourde, à plusieurs, chacun tente d’exister seul. C’est une logique d’occupation du territoire, pas une logique de construction de puissance.
Dorothy Rhau est claire : tant qu’on reste dans cette logique du « moi », on restera une addition d’initiatives, pas une force collective capable de négocier, d’influencer, d’orienter des politiques publiques ou des budgets.

Les racines du problème
Pour elle, trois moteurs nourrissent cette fragmentation.
1. Le besoin de reconnaissance individuelle.
Quand un projet commence à rayonner — par exemple un salon qui attire du monde, une campagne qui gagne de la visibilité, une initiative santé qui obtient de l’écoute —, au lieu de consolider cet acquis, d’autres lancent une structure similaire. Non pas toujours pour répondre à un manque réel, mais parfois pour « être la personne qui porte ça« . L’ego prend le volant.
2. Le réflexe “je ferais mieux”.
Plutôt que d’améliorer ce qui existe déjà (la qualité d’un événement, l’exigence d’un jury, la rigueur d’un programme d’accompagnement), on recrée ailleurs… parfois avec moins de préparation, moins de rigueur, moins de moyens. Le résultat : le niveau général baisse, la marque collective perd du poids.
3. L’effet subvention.
Dès qu’une enveloppe publique tombe, on voit apparaître des projets qui ressemblent beaucoup à ceux d’hier, renommés, repeints, repositionnés. On dépose, on justifie, on duplique. L’innovation devient un mot-clé administratif plutôt qu’un geste réel.
Au bout du compte, dit Dorothy Rhau, on ne parle plus vraiment de transformation économique, mais de survie d’organismes. Et ça, les bailleurs le voient.
Ce qu’elle demande : pas l’uniformité, la coordination
Important : Dorothy Rhau ne réclame pas un monopole. Elle ne dit pas « rejoignez toutes Audace au féminin ». Elle affirme exactement l’inverse : aucune organisation ne peut, à elle seule, répondre à toutes les réalités des femmes noires au Québec et au Canada. Il faut de la pluralité.
Tant qu’on refuse de nommer la dispersion, on organise nous-mêmes notre propre affaiblissement collectif.
Mais elle pose une condition : une pluralité organisée.
Concrètement, elle appelle à une cartographie claire de l’écosystème. Qui fait quoi ? Pour qui ? Avec quelle expertise réelle ? Qui accompagne les entrepreneures ? Qui travaille sur la santé ? Qui agit sur les enjeux de racisme institutionnel ? Qui œuvre dans le secteur culturel ? Qui touche spécifiquement les jeunes ? Qui s’adresse à telle région ?
Cette cartographie n’est pas cosmétique. C’est la base d’une table de concertation où les rôles sont assumés et complémentaires. Chacun reste souverain, mais pas isolé. On parle de co-développement, pas d’absorption.
Elle va plus loin : il faut aussi accepter la spécialisation. Tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne doit pas tout faire. Le respect mutuel passe aussi par l’acceptation que « ce champ-là n’est pas le mien !« .
Dorothy Rhau projette la question plus loin que le prochain gala. Elle dit, en substance : en 2030, est-ce qu’on veut juste plus d’événements, plus de logos, plus de photos de trophées… ou est-ce qu’on veut une communauté économiquement plus forte, plus crédible, mieux écoutée?
Pour ça, il faudra arrêter de produire des symboles parallèles — cinq galas, six salons, trois campagnes identiques — et commencer à produire du levier commun : une voix claire, des standards assumés, des actions coordonnées.

Conclusion : qui prendra la responsabilité politique de l’après ?
L’alerte est lancée : la dispersion actuelle nous coûte en crédibilité, en ressources et en pouvoir collectif. La piste est tracée : cartographier, se parler, se spécialiser, mutualiser, exiger des standards, aller chercher ensemble des enveloppes structurantes plutôt que se battre pour des miettes séparément.
Reste une question lourde, peut-être la plus délicate de toutes : maintenant que Dorothy Rhau a verbalement assumé ce diagnostic et proposé une voie de coordination, acceptera-t-elle d’en prendre le leadership concret — celui qui consiste à asseoir tout le monde autour de la même table et à tenir cette table vivante ?
Pour écouter l’entrevue avec Neoquébec :
La publication de Dorothy Rhau sur Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1GMqivMogK/?mibextid=wwXIfr
(c) Rédaction Neoquébec (octobre 2025)



