Une étude menée par l’Observatoire des communautés noires du Québec révèle un déficit majeur de représentation des personnes noires dans les organismes publics. Sur 258 institutions ciblées, une faible majorité a répondu, et encore moins ont fourni des données spécifiques. Résultat : un portrait incomplet, mais suffisamment inquiétant pour relancer le débat sur la transparence, la volonté politique et l’égalité réelle dans l’accès aux postes d’influence.
La diversité de la société québécoise progresse depuis plusieurs décennies, mais l’État reflète-t-il réellement cette pluralité culturelle au sein de ses propres structures ? Pour en avoir le cœur net, l’Observatoire des communautés noires a lancé une vaste enquête visant à dresser un portrait précis de la présence des personnes noires dans 258 organismes publics : ministères, sociétés d’État, grandes municipalités et établissements publics. Les résultats sont sans équivoque : la représentation demeure très faible, opaque et surtout mal documentée.
Une méthodologie rigoureuse, des réponses timides
L’étude s’est appuyée sur les procédures réglementées de la Commission d’accès à l’information. Sur les 258 organisations sollicitées, 124 ont répondu de façon exploitable concernant les minorités visibles. Ce premier chiffre est déjà révélateur : environ la moitié des institutions publiques manquent à leurs obligations légales. Pire encore, seules 38 ont fourni des données spécifiques aux personnes noires.
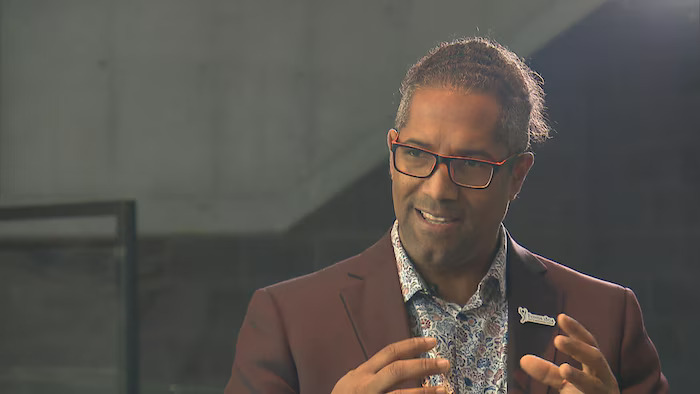
Ce déficit d’informations n’est pas anodin. Il empêche d’évaluer correctement les progrès, de cibler les lacunes et d’adapter les politiques publiques. Pourtant, rien dans la loi n’interdit de ventiler ces données de manière plus fine. Pour Édouard Staco, président du SDESJ (Sommet Jeunes Afro) et de l’Observatoire des communautés noires, « l’absence de réponse est souvent plus éloquente que les chiffres eux-mêmes« .
Un portrait inquiétant
Parmi les institutions ayant accepté de jouer le jeu, les résultats montrent que les personnes noires représentent environ 7 % de l’effectif global. Mais cette moyenne est trompeuse : elle est dopée par une surreprésentation dans le secteur de la sécurité privée, où les travailleurs sont nombreux et peu rémunérés. En fait, dès que l’on s’éloigne de ce segment, la présence noire s’effondre.
« Plus on monte dans la hiérarchie, plus les personnes noires disparaissent »
Aux postes de cadre, c’est pire . La proportion chute drastiquement sous la barre des 2 %. L’étude s’est attardée dans le domaine des ressources humaines – un levier stratégique pour le changement institutionnel – le résultat est éffarant ; on y atteint à peine 1 %. Autrement dit : dans le secteur et le services où l’on pourrait et devrait transformer les pratiques d’embauche et de promotion, le spersonnes noires sont presque absentes. Cette réalité crée un effet d’entonnoir : plus on grimpe, plus la diversité s’évapore.
Les angles morts statistiques
Et si le problème veait de la loi ? La catégorie « minorité visible » est souvent utilisée de manière globale, et pourtant dans cet immense ensemble, les trajectoires sont très différentes. Certaines communautés connaissent une ascension professionnelle rapide ; tandis que les personnes noires, elles, continuent de subir un retard salarial, et ce sur trois générations, selon d’autres études pancanadiennes récentes.
Cela pose une question fondamentale : l’État québécois se prive-t-il de talents précieux ?

Le manque d’uniformité dans la collecte de données trahit un problème plus profond : l’absence de mécanismes coercitifs. Aujourd’hui, une organisation peut ne pas répondre – ou répondre de manière partielle – sans conséquence réelle. Car sans données, impossible de mesurer l’efficacité des programmes d’inclusion, ni de comprendre les obstacles internes : biais de recrutement, absence de mentorat, plafonds de verre informels.
Et c’est la raison pour laquelle plusieurs experts demandent désormais des obligations plus strictes et des audits réguliers.
Un enjeu de cohésion sociale
Au-delà des chiffres, l’enjeu est sociétal. Pour Édouard Staco, les organismes publics financés par l’ensemble des contribuables devraient être exemplaires. La confiance institutionnelle passe par la représentativité. Si certaines communautés ne s’y reconnaissent pas, un sentiment d’exclusion peut s’installer, avec des répercussions profondes sur la participation civique et la mobilité sociale.
» Sans données, il n’y a ni responsabilité, ni progrès,
seulement l’illusion du changement, à l’instar de la Ville de Montréal »
Vers un avenir plus transparent
Cette étude n’est qu’un premier jalon, mais elle ouvre une porte essentielle : celle de la responsabilité publique. Le Québec affirme vouloir bâtir une société inclusive ; pour l’instant, ses institutions semblent encore en retard. La balle est dans le camp des décideurs.
Mais aussi du côté des principaux concernés, les citoyens. L’Observatoire des Communautés noires encourage la population à consulter l’étude (disponible sur leur site internet), à s’informer et à interpeller les élus. « Il ne s’agit pas d’accuser, mais de constater et d’agir « , insiste Edouard Staco.
La conclusion est limpide : l’inclusion ne se décrète pas, elle se mesure. Et quand on mesure, on progresse.
Ecoutez ici le 3ème épisode du podcast « L’Observatoire vous parle » :
(c) Rédaction – Institut Neoquébec (nov. 2025)




