Avec son nouveau recueil de textes, Petit Traité du racisme en Amérique, l’écrivain-académicien Dany Laferrière, analyse la haine qui empoisonne la vie des Noirs américains depuis les débuts de l’esclavage.
C’est un procédé littéraire qu’il affectionne et qu’il avait déjà utilisé dans L’Énigme du retour : des textes courts, comme des résumés de réflexions, alternant avec des chapitres plus longs. Dany Laferrière remet ça dans son Petit Traité du racisme en Amérique, qu’il publie en ce début d’année, chez Grasset. Son vœu : ne pas effaroucher avec une enquête lourde, chargée, le jeune lecteur, qu’il ne supporte plus de voir ressasser les mêmes clichés sur le racisme.
S’il se garde d’en donner une définition unique, l’auteur de, entre autres, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, Dans la splendeur de la nuit ou encore L’Art presque perdu de ne rien faire, voudrait « remettre de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu’est le racisme ». Le livre fourmille de thèmes mettant en évidence les ressentis, les désirs et les souffrances que peuvent éprouver les Noirs. Il foisonne également de figures emblématiques comme celles, éruptives, de Nina Simone et de Miles Davis, ou celles, plus consensuelles, de Toni Morrison ou de Spike Lee. Celles aussi, inattendues, de Cheikh Anta Diop et de Frantz Fanon. Se mêlent alors motifs d’affliction et motifs de fierté, actes de racisme ordinaire et lynchages du Ku Klux Klan… Dany Laferrière fait la démonstration du maniement tout en délicatesse d’un concept potentiellement explosif.
On ne vous a pas beaucoup entendu lors de l’affaire George Floyd, en 2020… Pourquoi un traité sur le racisme maintenant ?
J’avais publié dans un magazine français un article intitulé « Le racisme est un virus ». J’aime bien, lorsque survient un sujet juteux dont s’emparent journalistes, politiques, artistes et intellectuels, me tenir en retrait et y revenir, une fois que le soufflet retombe, pour écrire à partir des traces laissées. Je suis toujours un peu inquiet quand tout s’enflamme brusquement, comme si c’était quelque chose de nouveau. Malgré la tragédie et la douleur qu’il engendre, il faut rentrer cet événement dans un continuum pour ne pas donner l’impression de s’énerver constamment, sans chercher à voir par quel bout il faudrait s’attaquer au problème.
De toutes les façons, on n’en a pas fini avec le racisme…
Loin de là. Le racisme n’est pas qu’une question d’allergie à l’autre. C’est aussi un business – qui rapporte beaucoup aux associations, aux lobbies, aux marques sportives (Nike, Adidas…) qui ruinent les familles du ghetto et aux artistes –, notamment aux États-Unis où toute prise de parole sur ce sujet vaut son pesant d’or, en fonction du poids médiatique de celui qui prend position. Je ne prétends pas que tous ceux qui interviennent le font pour des intérêts personnels. Il y a néanmoins autour du racisme une forme de « dynamisme ».
Le raciste n’est pas que celui qui vous traite de « sale nègre ». Il peut s’agir d’un professionnel qui se met en travers de vos projets et vous empoisonne la vie
Quelle est, d’après vous, la spécificité du racisme aux États-Unis ?
Il y a d’abord le poids du nombre : de 45 millions à 48 millions de Noirs, soit potentiellement autant d’actes de racisme. Les États-Unis sont aussi l’une des rares puissances où l’esclavage s’est déroulé sur le territoire national – le voisin canadien l’a aussi pratiqué sur son sol, mais à une échelle moindre et il a même été considéré comme l’endroit où il fallait être pour s’en libérer.
Les États-Unis sont un laboratoire pour le racisme dans la mesure où ils permettent de faire des analyses très intéressantes. Ils sont allés plus loin qu’aucun autre pays dans l’abomination, plus haut qu’aucun autre dans la valorisation des Noirs : le pays s’est offert un président noir, des présidents de multinationales, des gouverneurs, des maires, des sénateurs, des députés noirs… De plus, aucune autre puissance colonisatrice n’a enregistré de guerre civile entre esclavagistes et abolitionnistes. Après l’abolition, les esclaves sont devenus des ouvriers. Du Sud esclavagiste au Nord ouvrier, la chaîne est invisible, mais elle demeure.
Est-ce que la colonne vertébrale de l’Amérique est imprégnée de racisme ?
James Baldwin l’a bien perçu. C’est une névrose. Personne n’en sort, pas plus les Blancs que les Noirs. Les uns ont été propriétaires à un moment ; les autres, esclaves. Hormis les nouveaux migrants, trois groupes cohabitent : les Anglo-Saxons, les autochtones et les Noirs. Tous ont une mémoire douloureuse – en particulier les deux derniers groupes – qui reste présente. Dans l’espace public, cette mémoire peut être ravivée à tout instant par une simple rencontre entre un Noir et un Blanc, ou entre un Blanc et un autochtone.
Pour certains, le racisme n’est qu’un ressenti dont il est malaisé de prouver le bien-fondé.
Le raciste n’est pas que celui qui vous traite de « sale nègre« . C’est plus subtil que ça. Il peut s’agir d’un professionnel qui se met en travers de vos projets et vous empoisonne la vie dans un but précis. Il estime qu’en aucun cas vous ne pouvez être de sa famille. Que vous êtes un étranger. Or les Américains noirs ne sont pas des étrangers aux États-Unis. Ils font partie de l’histoire et la richesse de leur pays repose en grande partie sur eux. Ce qui n’empêche pas le racisme américain d’être bien implanté et ses preuves sont tangibles. Les quartiers noirs sont différents des quartiers blancs : dans les premiers, des pylônes électriques, dans les seconds, des arbres. D’un côté, des parcs saccagés, de l’autre, des pelouses vertes tondues au millimètre près…
Selon vous, il est impossible d’extirper ce mal si on ne le saisit pas à la racine.
Le policier qui tire sur un Noir n’est que le bras armé d’un système, tout comme l’ouvrier raciste. Les ouvriers noirs et les ouvriers blancs sont utilisés comme de la chair à canon dans cette guerre. Placés les uns à côté des autres, ils doivent se battre sous le regard méprisant de décideurs qui, installés dans les tours de Manhattan, alimentent le racisme. Pourtant, ces décideurs ne peuvent être accusés d’être des racistes : ils ne voient jamais de Noirs, ne disent jamais rien contre eux…
 On ne résoudra pas la question du racisme tant que l’on ne s’intéressera pas aux personnes qui, loin du front, tirent les ficelles et attisent sournoisement la haine. Seulement, la police s’en prend davantage aux Noirs, lesquels sont aussi souvent à fleur de peau parce que écrasés, sous-payés et vivant dans des conditions difficiles. Ni le policier ni l’ouvrier blanc raciste, et ni le Noir complètement déboussolé n’ont conscience de faire partie d’un jeu qui les dépasse. Ils sont manipulés sur le terrain.
On ne résoudra pas la question du racisme tant que l’on ne s’intéressera pas aux personnes qui, loin du front, tirent les ficelles et attisent sournoisement la haine. Seulement, la police s’en prend davantage aux Noirs, lesquels sont aussi souvent à fleur de peau parce que écrasés, sous-payés et vivant dans des conditions difficiles. Ni le policier ni l’ouvrier blanc raciste, et ni le Noir complètement déboussolé n’ont conscience de faire partie d’un jeu qui les dépasse. Ils sont manipulés sur le terrain.
Cela explique-t-il que les Noirs soient fichés dès leur plus jeune âge même s’ils n’ont pas commis le moindre délit ?
Tout jeune Noir doit avoir un casier judiciaire avant ses 18 ans. Il suffit que la police rencontre l’adolescent seul dans la rue le soir. Même s’il est à deux pas de son domicile, en l’absence d’une pièce d’identité, il est conduit dans les locaux de la police, qui l’inscrit dans ses fichiers. La prochaine fois que cela se produira, il sera un récidiviste. À l’inverse, lorsqu’un jeune Blanc se trouve dans la même situation, il est ramené chez ses parents.
La difficulté de venir à bout du racisme ne tient-elle pas aussi au fait que la classe moyenne, c’est-à-dire la majorité, ne se sent pas concernée ? Soit la parce qu’elle est persuadée de ne pas être raciste, soit parce qu’elle ne l’a jamais vécue.
La classe moyenne, c’est l’être mystère de l’Amérique. On la courtise pour ses voix lors des élections et parce que c’est elle qui définit les tendances. C’est sur elle que reposent l’économie, la politique, voire le rêve américain. Préoccupés par des problèmes bien réels comme gagner de l’argent, ces Américains de la classe moyenne abandonnent les victimes de racisme à leur sort. Or c’est un fléau qui ne peut être pris isolément. Inutile de feindre de l’ignorer : il finit toujours par rattraper ceux qui s’en détournent, parce qu’il est aussi présent dans l’espace public que l’oxygène, cet oxygène qui a manqué à George Floyd.
Accepter que l’on accole un adjectif comme afro, noir, etc. c’est un peu abandonner le combat en cédant le statut d’américain à l’autre
Comment le vaincre ? Quel pourrait être le rôle de la littérature dans un tel combat ?
 Il fut un temps où les auteurs Noirs des États-Unis écrivaient leurs œuvres en prison, s’ils n’avaient pas été lourdement condamnés. Beaucoup racontent dans leurs Mémoires comment la prison les a structurés intellectuellement et leur a permis d’échapper au rouleau compresseur de la rue, mais aussi à cette machine à broyer qu’est le racisme et dont les fondements sont l’humiliation et le mépris. Chaque fois que l’on écrit, on prend de la distance avec le racisme, même si on ne l’éradique pas. C’est rare de se sentir inférieur quand on écrit. Il y a une sorte de dignité dans les lettres.
Il fut un temps où les auteurs Noirs des États-Unis écrivaient leurs œuvres en prison, s’ils n’avaient pas été lourdement condamnés. Beaucoup racontent dans leurs Mémoires comment la prison les a structurés intellectuellement et leur a permis d’échapper au rouleau compresseur de la rue, mais aussi à cette machine à broyer qu’est le racisme et dont les fondements sont l’humiliation et le mépris. Chaque fois que l’on écrit, on prend de la distance avec le racisme, même si on ne l’éradique pas. C’est rare de se sentir inférieur quand on écrit. Il y a une sorte de dignité dans les lettres.
James Baldwin en a fait la démonstration, notamment avec La Prochaine Fois, le feu ou encore avec Nobody knows my name.
Oui, à la surprise de l’establishment blanc, qui se demandait comment ce jeune homme noir, qui n’était pas allé à Harvard, parvenait à analyser sa condition avec autant de lucidité. Baldwin va au-delà de la question du racisme. Dans Nobody knows my name, il explore la vie d’un intellectuel français sophistiqué, André Gide, dont il examine le rapport à l’homosexualité, ce grand tabou de l’Amérique des années 1950. Par la puissance de sa réflexion, Baldwin démontre qu’il ne peut laisser le premier venu l’humilier en raison de sa couleur de peau. Il a permis à de nombreux jeunes Américains, noirs et blancs, de réfléchir, leur rappelant qu’ils ne peuvent s’en sortir seuls. Tant que le Noir sera écrasé, le Blanc fera partie des bourreaux, même si ses meilleurs amis sont noirs. Seule solution ? Devenir l’un et l’autre des Américains à part entière.
Baldwin arrive-t-il à cette conclusion parce qu’il rejette toute radicalité dans le combat contre le racisme ?
Il privilégie la force de la persuasion et de la nuance. Grâce à cette nuance on fait passer à son interlocuteur le message suivant lequel il n’est pas irrémédiablement raciste. Tout être humain a besoin de cette nuance, y compris les membres du Ku Klux Klan.
Sans ces nuances, vous n’auriez pas pu vous saisir d’un sujet aussi explosif que celui du racisme ?
La nuance est subversive. Mon but n’est pas d’opposer de manière frontale le Noir et le Blanc. Et, lorsque j’écris le mot Noir, il n’englobe pas tous les Noirs, pas plus le Blanc ne réunit tous les Blancs. Introduire la nuance, c’est rappeler quelques vérités : des milliers de jeunes Blancs sont morts lors de la guerre de Sécession pour une cause dont ils n’avaient pas idée. À la fin des années 1930, prenant le risque d’entraver la réélection de son mari à la Maison-Blanche, Eleanor Roosevelt démissionne de la puissante association Filles de la révolution américaine, en réaction à l’interdiction faite à la chanteuse noire Marian Anderson de se produire dans l’auditorium du Constitution Hall.
Mieux, la Première dame s’attirera les faveurs de la communauté noire en invitant la contralto à chanter au pied de la statue de Lincoln, devant plus de 75 000 spectateurs toutes origines confondues. Et comment oublier que c’est Janis Joplin qui fit graver la tombe anonyme de Bessie Smith ces mots : « La plus grande chanteuse de blues au monde ne cessera jamais de chanter – Bessie Smith 1894-1937 « . On pourrait multiplier les exemples où Noirs et Blancs ont été dans le même camp.
 Vous réhabilitez également Harriet Beecher Stowe, auteur de La Case de l’oncle Tom, un livre injustement honni alors qu’il a contribué à motiver des jeunes du Nord ouvrier à se battre contre le Sud esclavagiste.
Vous réhabilitez également Harriet Beecher Stowe, auteur de La Case de l’oncle Tom, un livre injustement honni alors qu’il a contribué à motiver des jeunes du Nord ouvrier à se battre contre le Sud esclavagiste.
Encensé par la jeunesse des années 1850-1860, l’ouvrage est descendu en flèche un siècle plus tard par les jeunes Noirs des années 1960. L’oncle Tom, le héros principal, est un être bon, aimé de tous à la plantation, qui répond au mal par le bien. Féministe, humaniste et abolitionniste, Beecher Stowe en appelle à la morale chrétienne qui traverse la société américaine d’alors pour répondre à des questions essentielles : un homme aussi bon peut-il être maintenu en esclavage ? Combien d’oncles Tom y a-t-il en Amérique ? Un méchant esclavagiste vaut-il mieux qu’un oncle Tom ? La rumeur a fait de ce dernier un individu au tempérament de serviteur, capable d’aimer son bourreau. Si Beecher Stowe a été vilipendée, la plupart des grands écrivains noirs ont toujours considéré son roman comme un livre majeur.
Je trouve absurde que l’on s’interroge sur l’apport des Noirs Américains à la culture américaine puisqu’ils en sont à l’origine, autant que les Blancs
Dans votre galerie de portraits figurent plusieurs femmes noires, dont Maya Angelou et Toni Morrison.
Une année lie les deux femmes : 1993. La première est choisie par Bill Clinton pour lire un poème lors de son investiture. La seconde obtient le prix Nobel de littérature. Une année faste donc pour deux femmes noires puissantes, élevées au plus haut niveau dans la société. Brillante, impertinente, sensuelle et attaquée tant par le Ku Klux Klan que par des Noirs, Maya Angelou n’a jamais voulu être considérée comme une victime. Elle fait partie de ces Américains qui ont séjourné en Afrique, notamment au Ghana, après les indépendances.
L’Afrique était alors perçue par des Américains noirs comme un rempart contre le racisme. Pourquoi cela n’a pas fonctionné ?
Parce que l’Afrique n’est pas l’Amérique. Comme l’a si bien dit Baldwin, les Américains noirs ne retourneront pas en Afrique et les Américains blancs ne se réinstalleront pas en Europe. On ne règlera pas le problème du racisme en dehors du territoire américain, là où on est né et où on est mort, en ignorant l’histoire qui s’y est déroulée, c’est-à-dire trois siècles d’esclavage. L’Afrique est une rêverie. De toutes les façons, les Américains noirs à l’étranger sont avant tout des Américains. On aimerait tant qu’ils le soient chez eux aussi.
Qu’ils cessent donc d’être des Noirs Américains ?
Accepter que l’on accole un adjectif (afro, africain, noir, etc.) ou un trait d’union à son identité, c’est un peu abandonner le combat en cédant le statut d’Américain à l’autre, en se situant à la marge. Je trouve ainsi absurde que l’on s’interroge sur l’apport des Noirs américains à la culture américaine puisqu’ils sont autant que les Blancs à l’origine de cette culture. Qu’ils soient rappeurs, athlètes ou scientifiques, les résultats de leurs travaux restent des contributions américaines ; ce ne sont ni des apports ni des ajouts. Comme disait Montaigne, les questions politiques sont souvent des questions de grammaire. Il faut commencer par nettoyer le vocabulaire. La société admet certains termes parce qu’ils font consensus. Par exemple, dire que je suis noir. Chacun sait que ma couleur de peau n’a rien à voir avec le noir. Rejeter ce consensus, c’est refuser un signe distinctif.
Vous évoquez aussi des personnalités éruptives, telles Nina Simone et Miles Davis.
Ce sont deux écorchés vifs, des blessés qui avaient le monde à leurs pieds, mais dont l’esprit est resté dans les plantations, ce qui explique qu’ils soient si abrasifs. On ne peut pas les toucher, ils refusent toute négociation, ne comprennent pas qu’un autre être humain puisse imaginer leur être supérieur. Vous les remettez dans les plantations, ils retrouvent leurs réflexes, comprennent qu’il leur faut fuir, aller dans les montagnes, se cacher, empoisonner les puits.
Pourquoi Cheikh Anta Diop se retrouve-t-il dans cette galerie de portraits ?
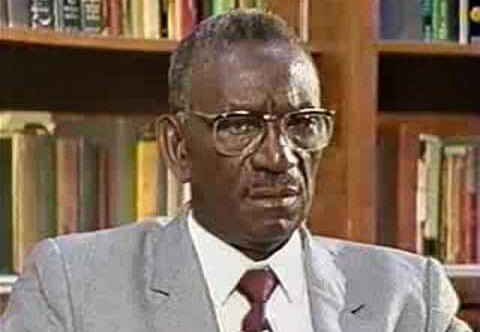 Le racisme ne concerne pas uniquement les Américains noirs nés aux États-Unis. Dans les années 1960, alors que ces Américains cherchaient à reconstituer leur histoire, Cheikh Anta Diop leur a offert celle de l’Égypte des pharaons. L’œuvre d’Anta Diop est plus étudiée aux États-Unis que dans son propre pays, le Sénégal.
Le racisme ne concerne pas uniquement les Américains noirs nés aux États-Unis. Dans les années 1960, alors que ces Américains cherchaient à reconstituer leur histoire, Cheikh Anta Diop leur a offert celle de l’Égypte des pharaons. L’œuvre d’Anta Diop est plus étudiée aux États-Unis que dans son propre pays, le Sénégal.
En même temps que vous dénoncez le racisme, vous déplorez que certains sortent si souvent la carte raciale qu’elle passerait pour une carte de visite.
Ceux qui brandissent ainsi la carte raciale en toutes circonstances sont des victimaires. Vous leur dites bonjour, ils croient déceler dans votre ton des relents racistes. C’est de la manipulation d’identité, car ils en tirent profit. Chaque exclu qui sort la carte raciale en toute circonstance finit par en faire commerce. En général, les victimaires n’affrontent pas les racistes décomplexés.
Votre livre s’ouvre sur un mot que vous affectionnez, mais qui pourtant ne fait pas consensus. Le mot nègre.
Je le trouve beau. C’est un mot riche et trouble, qui a plusieurs significations suivant la personne qui l’emploie. Sur la couverture d’un livre, il prend tout de suite des éclats. Il n’a rien à voir avec le mot anglais nigger, plus violent, que les rappeurs utilisent pour le déminer, pour en supprimer la charge explosive. En Haïti, il signifie tout simplement « homme« . Si on peut l’utiliser aussi facilement, c’est parce que Haïti est sortie de la névrose coloniale par un processus bien étrange : l’arrivée du dictateur noir. Un Noir se servant d’autres Noirs, les Tonton macoutes, pour écraser d’autres Noirs, lesquels en ont déduit que ce n’était pas le Blanc le problème. Les colons noirs remplaçant les colons blancs, c’était une question de pouvoir plus qu’une question raciale.
Certains suggère de le supprimer…
C’est ridicule. Ne pas le dire ne signifie pas qu’on en pense moins. Devrait-on aussi supprimer les mots esclaves, holocauste, nazi, camp de concentration ? Il faut les conserver pour savoir qui les disait, dans quel contexte, avec quelles conséquences et quelle violence. On veut savoir de quelle manière l’Histoire a évolué.
Il y a-t-il une période de l’histoire des États-Unis où l’on a l’impression de voir le racisme reculer ?
Le Ku Klux Kan a connu une période de mou, lorsque les Black Panthers sont arrivés, très bien habillés, arborant avec style blousons noirs, bottes et chapeaux. Les Noirs prenaient ainsi sur leurs épaules le fardeau de l’esthétique. Les photos de l’époque ne laissent pas deviner leur statut d’ouvriers. Cela peut sembler futile, mais c’était très politique : ils rejetaient leur condition. L’esthétique devenait une force, une arme puissante. Désormais, les Blancs régnaient sur le jour ; eux, sur la nuit, la fantaisie, l’imaginaire. L’esthétique a freiné la montée du Ku Klux Klan, car ses jeunes recrues ne souhaitant plus revêtir la légendaire taie d’oreiller percée de deux trous.
Source : Jeune Afrique / Clarisse Juompan-Yakam (Mars 2023)
Petit Traité du racisme en Amérique, de Dany Laferrière, Éd. Grasset, 256 p.




